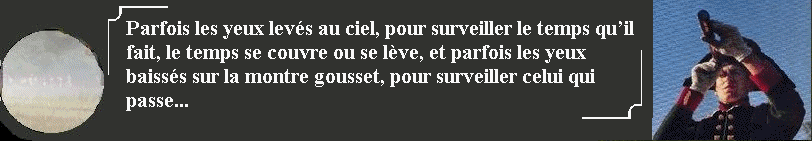Chapitre 1. La coopération militaireArghentur a écrit : Oui. Car en ce moment l'Otan n'est pas de taille à lutter contre les Russes. De plus l'ONU est inutile car il y a plus de guerre qu'en 1980 et la famine est toujours aussi présente je rappelle que l'ONU est un organisme chargé de combattre la guerre et la famine aussi.
L’union occidentale créée par le pacte de Bruxelles du 19 mars 1948 a servi de noyau à la création de l’OTAN. L’organisation internationale elle-même s’est transformée en 1954 pour laisser place à l’Union de l’Europe Occidentale, le but étant de permettre le réarmement de l’Allemagne. Initialement, ce processus aurait du s’inscrire dans le cadre d’une véritable communauté Européenne de défense, mais une coalition des communistes et des gaullistes au sein de l’assemblée française avait mené à l’échec de ce projet.
A la fin des années 90, la France a proposé de réactiver l’OTAN de manière à en faire un pilier européen de sécurité. Les états se sont alors efforcés de la dotée de moyens militaires un peu plus importants.
En 1997, les missions de l’UEO sont transférées auprès de l’Union €uropéenne. En 1999, l’U€ va commencer à se doter d’organes propres qui lui permettront d’assumer ses missions, elle se dote progressivement d’une force militaire crédible. L’UEO retombe dans un profond sommeil puisque certains de ses organes ont été transférés à l’Union, c’est elle qui va constituer la base de la défense européenne. L’UEO existe toujours, elle rassemble les états membres de l’Union, elle est en théorie un système de défense collective, pour le reste, elle va gérer les archives et les retraites de ses fonctionnaires.
Donc aujourd’hui la principale organisation est l’OTAN. Dès la signature du pacte de Bruxelles en 1948, l’idée de former un système de défense avec les états unis s’était fait jour, l’aggravation du contexte politique du blocus de Berlin va en accélérer la réalisation. Pour les états européens l’alliance avec les états unis apparaît comme le seul moyen pour régler l’équilibre des forces.
Dès 1949 le traité de l’Atlantique nord est signé. Ce traité créé une alliance militaire très faiblement institutionnalisée, c’est de façon très empirique que l’alliance s’est dotée d’organes permanents. L’OTAN résulte du traité du 4 avril 49 mais juridiquement, ce n’est pas ce traité qui le créé.
L’OTAN est donc un pur produit de la Guerre Froide, l’objectif premier étant de répondre à une menace communiste. Lorsque l’US disparaît, lorsque la bipolarité disparaît, l’OTAN semble perdu.
Mais lors du sommet de Rome en 1991, les états membres ont estimé nécessaires de la maintenir pour rester capables de faire face à tous les risques pour leur sécurité qui peuvent provenir de situations d’instabilité ou de tensions.
Section 1. Le nouveau concept stratégique de l’OTAN
L’évolution du contexte internationale a forcé un réaménagement de l’OTAN se traduisant par une extension de ses missions, un adaptations de ses structures et une nouvelle entente avec les anciens membres du Pacte de Varsovie.
§ 1. L’extension des missions
A/ Les missions traditionnelles
A l’origine et durant 50 ans, le Traité Atlantique Nord s’est exclusivement défini comme étant un pacte parfaitement régional. L’objectif était de garantir la sécurité de la zone Atlantique Nord, l’alliance reposant sur 3 séries de mécanismes définis aux articles 3, 4 et 5 du Traité.
Art 3 : En temps de paix, les alliés s’engagent à maintenir et développer leurs capacités individuelles et collectives de résister à une agression. Cela implique la définition du doctrine stratégique commune avec la présence de troupes américaines sur le sol européen.
Art 4 : Une menace contre l’intégrité, l’indépendance ou la sécurité d’un allié conduit à des consultations mutuelles.
Art 5 : En cas d’agression contre un ou plusieurs alliés, l’attaque est considérée comme étant portée sur l’alliance toute entière. En conséquence, chacun des autres états prend les moyens de son choix y compris l’emploi de la force pour assurer la zone de sécurité de l’alliance de l’AN.
Le mécanisme de l’article 5 a surtout une portée dissuasive, en cas d’attaque, si l’assistance est obligatoire, celle militaire ne l’est pas. L’article 5 n’aura jamais trouvé à s’appliquer au moment de la Guerre Froide. Contexte appliqué dans la lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre, les Etats-Unis ont souhaité avoir le soutien logistique de l’OTAN, notamment aérien et maritime pour contrôler la zone méditerranéenne.
B/ Les nouveaux objectifs
Dans la mesure où le Traité n’a pas été révisé, c’est à l’occasion de différents sommets que le mandat de l’OTAN a été redéfini. C’est lors du sommet de Romme des 7-8 Novembre 1991 et lors du Sommet de Washington des 23 -24 Avril 1999 que seront revus les objectifs de l’OTAN. Il en ressort que l’OTAN n’est plus seulement un instrument de défense collective, l’organisation doit au-delà contribuer à garantir la paix et la sécurité et la stabilité sur le continent européen, y compris dans des crises extérieures à ses Etats membres. Il y a un relais national des Nations Unies susceptible de s’appliquer soit dans les opérations de maintien de la paix, soit dans les action coercitives décidées par le Conseil de Sécurité (Chapitre 7 de la charte de San Francisco concernant les sanctions prises par le Conseil de l’ONU. Système qui n’a pas trouvé à fonctionner lors de la Guerre Froide et réactivé lors de la Guerre de Golfe. Au terme du Chapitre 8, la responsabilité principale de l’ONU n’exclut pas l’intervention de forces régionales qui doivent agir sur mandat du conseil de sécurité et d’une manière compatible avec la charte).
Très vite, le contexte international a permis de faire la preuve de ce nouveau concept stratégique, l’intervention en ex-Yougoslavie en a été la première implication. Dans un premier temps, l’OTAN a contrôlé et fait respecter l’embargo contre les armes décidé par les Nations Unies pour toute l’ex-Yougoslavie et les sanctions économiques, l’embargo commercial décrété plus spécifiquement contre la Serbie Monténégro. L’alliance au aussi contrôlé et interdit le survol de la Bosnie-Herzégovine. Son application dans le conflit s’est ensuite renforcée, de septembre 1996 à décembre 2004, l’OTAN a dirigé la force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine, afin de maintenir des conditions de sécurité satisfaisantes et de faciliter, bien sûr, la reconstruction du pays. Deuxième temps, la Bosnie envoie des contingents suivant les accords de Dayton. Dans un troisième temps, l’OTAN a organisé la défense et la sécurité au Kosovo. Le Président Milosevic n’étant pas prêt à se plier à un accord de paix définitif, l’OTAN a pris l’initiative de soumettre la Serbie à des frappes aériennes massives.
Durant Juin 1999, l’OTAN a sorti plusieurs milliers de missiles, endommageant des dégâts collatéraux. Les principes de la charte n’ont pas été appliqués car le Conseil n’avait pas donné mandat pour recourir aux armes, ils ont donc du donner un mandat aux troupes de l’OTAN pour pouvoir faire appliquer la sécurité au Kosovo, fameuse KFOR. Totalement en dehors du champ traditionnel de l’Alliance, la sécurité des alliés n’était pas compromise, la crise était totalement extérieure et la Guerre en Ex-Yougoslavie témoigne d’une ingérence de l’OTAN dans un conflit qui était intra-étatique au nom de principes supérieurs du droit tels que les droits de l’homme. Il fallait protéger les Kosovars de l’entreprise de « purification » lancée.
Depuis, l’OTAN s’est également engagé à la demande du gouvernement local à un maintien de la paix en Macédoine. Entre 2002 et mars 2003, elle a notamment contribué à désarmer les insurgés, en août 2003, l’OTAN a tout naturellement pris le commandement de la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité (FIAS) en Afghanistan menant donc pour la première une mission en dehors même du continent européen. C’est une mission s’étant poursuivie jusqu’en 2005. Dans cette même ligne d’idée, elle a fourni un moyen logistique à l’Union Africaine dans la gestion de la crise au Darfour. L’action de l’OTAN a consisté à des transports aériens mais aucun contingent n’a été déployé en Afrique.
L’OTAN est donc désormais capable d’intervenir sur tous les continents, il lui faut donc des moyens beaucoup plus mobiles que ce qu’elle avait pour la simple défense, d’où une adaptation des structures.
§ 2. L’adaptation des structures
Dès l’origine, l’OTAN a eu des spécificités en rapport à son organisation tenant à une structure politique, civile et d’une structure militaire. La formule politique n’a pas changé depuis le début, touchant uniquement le secrétariat, mais la structure militaire a été profondément réformée.
A/ Une structure politique inchangée
Le principal organe de l’OTAN est le Conseil Atlantique Nord. Les gouvernements sont représentés par leurs ministres des affaires étrangères éventuellement selon l’ordre du jour, par les ministres de la défense ou les ministres de la défense. A l’échelon ministériel, le Conseil tient 2 sessions par an.
Chaque Etat membre nomme un représentant permanent assisté d’une délégation nationale, le Conseil Atlantique Nord se réunit une fois par semaine. Chaque Etat conserve donc une faculté d’empêcher une situation.
Le Conseil est appuyé par un grand nombre de comités, de groupes de travail ou de planification, à ce titre on doit tout particulièrement mentionner le Comité des Plans Nucléaires et le Comité des Plans de défense.
[Par ailleurs, une assemblée parlementaire constituée des membres des parlements nationaux occupe une place tout à fait marginale dans la structure décisionnelle de l’OTAN, dans l’ensemble, les assemblées détiennent un pouvoir consultatif et dans la structure de l’OTAN elle n’a pas de poids. Il est question ici d’un échange de vue entre les parlements nationaux.]
Enfin, le Secrétariat Général qui depuis 1956 préside le Conseil Atlantique Nord via son Président, ainsi que les Comités décisionnels de haut niveau. Le secrétaire général est plus particulièrement chargé de gérer la consultation entre les Etats membres, il dirige l’administration et c’est lui qui représente l’OTAN à l’extérieur. Il est nommé par les Etats membres et dispose d’un mandat de 4 ans. Le Secrétariat a été réorganisé en 2003 afin de s’adapter aux nouvelles priorités de l’organisation, il comporte 6 directions nationales, il se charge aussi de la décision exécutive devant permettre d’organiser l’efficacité du secrétariat, le développement des opérations qui gère les activités de l’organisation en matière de gestion des crises ou de maintien de la paix au niveau politique et régionale impliquant la sécurité du continent européen et des relations avec des organisations internationales comme l’ONU ou l’U€.
En outre, le secrétariat se voit adjoindre un bureau de sécurité de l’OTAN chargé de coordonner, de contrôler et de mettre en œuvre la politique de sécurité de l’organisation.
B/ Une structure militaire réformée
L’organe militaire de l’OTAN est le Comité Militaire constitué des chefs d’Etat-Major de tous les Etats membres sauf pour l’Islande qui n’a pas d’armée. C’est le comité militaire est qui responsable des activités militaires de l’organisation, à ce titre il convient d’adresser des recommandations politique, il exerce donc une fonction consultative auprès du Conseil Atlantique Nord, du Comité des plans nucléaires. Il est assisté par l’Etat-Major international qui entreprend des plans et des études. A ce niveau, la structure militaire n’a pas été modifiée. En revanche, les commandements de l’OTAN on été profondément restructurés. Cet aspect qui est le plus opérationnel est aussi le plus crucial. Au niveau stratégique, l’OTAN auparavant 2 commandements interalliés, font les fonctions étaient similaires mais dont les compétences territoriales étaient distinctes, le SACEUR gérait la zone Europe et le SACLANT quant à lui, gérait la zone atlantique.
Depuis Juin 2003, cette dissociation a été abandonnée, au profit d’une nouvelle distinction entre le commandement opération et le commandement transformation. Le commandement opération a son siège en Belgique et il se voit adjoindre un commandement transformation, qui pour but de seconder l’opération et d’améliorer les entraînements conjoints. D’élaborer et d’expérimenter de nouvelles doctrines stratégique. En dessous, à la place des 5 commandements régionaux, depuis Juin 2003, ils sont remplacés par 2 commandements de force interarmées. Enfin, on trouve en dessous, l’autant était doté de 13 commandements subordonnés, leur nombre est réduit à 6.
En même temps que l’OTAN s’est efforcé de restructurer son commandement, elle a procédé à une reconfiguration de ses forces. Dès 1994, les Chefs d’Etat et le gouvernement des alliés ont souscris au principe des Groupes de Forces Interarmées Multinationales (GFIM) qui seraient adaptables selon les besoins et donc susceptible de mener des opérations auxquelles participeraient des pays extérieur à l’OTAN.
En novembre 2002, lors du sommet de Prague, il avait été décidé par l’intermédiaire des Etats-Unis, de créer une force de réaction rapide la NRF, il atteint une force de 17K en octobre 2006, sa capacité opérationnelle finale étant de 21K. La NRF est une unité d’élite qui dispose de technologies de pointe, et il combine des forces terrestres, navales et aériennes. Elle est capable de soutenir de manière autonome ses opérations pendant un mois, ses missions ont varié, elle peut être chargée d’effectuer des évacuations de civils, de gérer les conséquences d’une catastrophe naturelle, mais aussi de contribuer à la lutte contre le terrorisme et en cas de conflit armé, peut servir de force d’entrée initiale, conformément aux initiatives de capacité de défense arrêtées en 1999 par l’OTAN.
§ 3. La redéfinition des relations avec les anciens membres du Pacte de Varsovie
A l’origine, la composition de l’OTAN reflétait à sa signature en 49 la position de l’Europe de l’Ouest face au bloc Soviétique. Au départ 12 Etats : France, Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas, le Danemark, l’Islande, la Norvège, le Portugal et l’Italie ainsi que les Etats-Unis et le Canada.
A partir de 1952, s’y sont adjoints deux autres Etats, la Turquie et la Grèce, puis la République Fédérale d’Allemagne et enfin en 1982, l’Espagne. Lorsque l’US disparaît, la composition de l’OTAN n’avait pas été modifiée. Assez rapidement, certains anciens satellites de l’Unions Soviétique ont demandé à entrer dans l’organisation, donnant le départ à un moment d’élargissement de l’Otan mais faisant aussi apparaître des formes parallèles de coopération soit sur la base de l’élargissement, soit sur la base d’une coopération.
A/ L’élargissement de l’OTAN
Dès le début des années 90, les pays du groupe de Visegrad –Pologne, République Tchèque, Hongrie…- avaient demandé à entrer dans l’OTAN. Leur candidature s’opposaient toutefois à 2 types d’obstacles, technique, leurs systèmes militaires ne correspondaient pas aux normes de l’OTAN, politique, la Russie, soucieuse de conserver sa maîtrise sur son proche voisinage était très hostile à leur adhésion. La conjonction de ces deux séries de considérations explique donc que leur candidature ait tout d’abord été repoussée, l’OTAN créant déjà le 20 Décembre 1991 le Conseil de la Coopération Nord-Atlantique, le COCONA, afin d’établir une coopération en matière de stratégie militaire, de planification des défenses et de politique de désarmement.
Une nouvelle demande d’adhésion a échoué en 1994, conduisant l’OTAN a renforcer la coopération, les 10 et 11 janvier 1994, le Partenariat Pour la Paix, PPP, était instauré.
En définitive, le premier élargissement de l’OTAN n’intervient qu’à la fin des années 90 avec la signature, le 16 décembre 1997 du protocole d’adhésion de la Pologne, de la Hongrie et de la République Tchèque leur rentrée effective datant de 1999.
Une seconde vague d’adhésion a été lancée en 2002 et aboutie le 29 Mars 2004 à l’entrée de 7 nouveaux membres, la Slovénie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie. A l’heure actuelle, l’OTAN compte 26 membres.
Autre plan fixé pour l’adhésion avec l’Albanie, la Croatie et de l’Ex-République de Macédoine.
B/ La coopération par l’Européenne
Il faut distinguer les principes généraux des relations bilatérales institués avec certains membres du Pacte de Varsovie.
1) La partenariat bi-atlantique
Ce partenariat repose principalement sur le partenariat pour la paix qui à l’heure actuelle, rassemble 20 Etats d’Europe Centrale Orientale, issus de l’Ex US ou membre de l’OSCE mais ayant adopté un statut de neutralité. L’objectif principal du PPP est d’accroître l’interopérabilité entre les forces de l’OTAN et celles des partenaires, autrement dit, l’objectif principal du PPP est d’aider les Etats partenaires à mettre sur pied des forces qui seront capables de participer à des opérations de maintien de la paix aux côtés de l’OTAN. A cette fin, des programmes de partenariats individuels sont établis pour une durée de 2 ans dans le domaine de la gestion des crises, des plans civils d’urgence en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents industriels majeurs, d’armement et bien sûr, de coopération militaire. L’examen qui a lieu tous les 2 ans, permet de déterminer quelles forces vont pouvoir être mises à disposition, qu’il s’agisse de mener des activités de formation, des exercices conjoints, a fortiori, des activités de terrain à caractère international. La participation au PPP donnant accès à la procédure de consultation prévue à l’article 4 du Traité Atlantique Nord.
Parallèlement, le COCONA s’est transformé en 1997 pour devenir le Conseil de Partenariat Euro-Atlantique, CPEA, qui rassemble les 46 représentants des membres de l’OTAN et des partenaires de l’OTAN. Cet organe se réunit au moins une fois par mois au niveau des ambassadeurs, une fois par an au niveau des ministres des affaires étrangères, très occasionnellement au niveau des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Le CPEA offre un cadre politique de négociation pour tous les aspects de la coopération entre l’OTAN et ses partenaires, de la sécurité régionales jusqu’à la question environnementale. Ces deux mécanismes (PPP et CPEA) se sont développés conjointement, ils ont les mêmes états et les mêmes valeurs mais leurs fonctions sont différentes, le PPP revêt un caractère opérationnel et le CPEA est plus dans la discussion générale. En raison de leur complémentarité, les chefs d’Etat et de gouvernement des membres de l’OTAN ont décidé en Novembre 2002 de réexaminer l’ensemble des modalités de partenariat.
2) Les relations privilégiées avec la Russie & l’Ukraine
Le 27 Mai 1997, l’OTAN et la Fédération de Russie ont conclu un Acte Fondateur, sur leurs relations mutuelles et la coopération entre l’Alliance et la Fédération. L’Acte revêt une forte dimension symbolique, après la Guerre Froide et la position bipolaire, les principes qui l’énoncent sont extrêmement classiques, proches de ceux déjà définis dans le cadre de la CSCE/OSCE, l’Acte Fondateur insiste donc sur la souveraineté, le respect, l’indépendance, l’intégrité territoriale, le non-recours à la force et la transparence mutuelle dans la formulation et des discussions sur la mise en œuvre des politiques de défense. Un conseil conjoint permanent qui offrirait des mécanismes de consultation, de coordination et dans toute la mesure du possible des mécanismes de décision et d’action conjointe sur des questions de sécurités présentant des aspects communs. Le contexte international n’a cependant pas permis d’appliquer immédiatement ces dispositions. Pour protester contre l’intervention de l’OTAN au Kosovo, la Russie a décidé de gérer toute relation avec l’Organisation, de sorte qu’il faudra attendre Mai 2002, pour que le Conseil OTAN-Russie (COR) fasse effectivement son apparition. Conformément aux principes de base, les consultations ne s’étendent pas aux affaires internes, soit des membres de l’OTAN, soit de la Fédération de Russie et au-delà, aucune des deux parties détient un droit de veto sur les actions et les activités de l’autre. Consultant ne voulant aucunement signifier acte de regard. Il existe toujours des moyens de modifier cet équilibre. Il est parvenu en 2004 un plan d’action conjoint sur le terrorisme. Un partenariat a été fixé avec l’Ukraine par une Charte du 9 Juillet 1997 complétée à partir de Novembre 2002 par un plan d’action OTAN-Ukraine.
Section 2. Le nouvel équilibre entre les piliers européens et américains de l’OTAN
Dès l’origine, l’Alliance était marquée par un certain déséquilibre des forces puisque si elle avait été conclue c’est parce que les pays Européens étaient dans une situation fragile, incapables de résister à la menace soviétique. Ce déséquilibre originel pose cependant d’avantages de difficultés dans le nouveau contexte européen, d’où la définition de nouveaux agendas qui viennent rythmer l’organisation de l’OTAN et qui bouge aussi l’appui apporté au développement d’une identité européenne d’une sécurité et d’une défense.
§ 1. Les agendas de l’OTAN
Durant tout le temps de la Guerre Froide, l’Article 5 du Traité de l’Atlantique Nord n’a jamais eu à rentrer en application et pour l’essentiel, l’Alliance s’est concrètement traduit par des discussions et de la coopération. Mais par l’élargissement de ses opérations, l’OTAN est de plus en plus intervenu sur le terrain. L’intervention au Kosovo a particulièrement mis au jour une fracture entre les capacités américaines et celles des alliés européens.
90% des munitions de guidage de précision ont été fourni par les Etats-Unis, de même que l’intégralité de la capacité de brouillage de l’OTAN, les Etats-Unis ayant assuré 90% de la sécurité air-sol et 80% des avions de ravitaillement en vol. Campagne menée au nom de l’OTAN mais d’un point de vue de la logistique, essentiellement américaine, les Etats Européens étant incapables de fournir cet équipement.
En conséquence et au vu de cette expérience, l’Agenda de Norfolk lancé en 2002 va se focaliser sur les changements en matière de capacité, appelant les alliés européens à des efforts particuliers pour renforcer leur capacité militaire et stratégique.
De même, l’intervention en Afghanistan a mis au jour un profond décalage entre des déclarations ambitieuses et des aptitudes concrètes à aligner des forces sur le terrain, en conséquence, définition d’un nouvel agenda, complémentaire du précédent, Agent de Prague en 2004 qui se concentre plutôt sur les changements nécessaires en matière de planification de la défense, de constitution des forces.
A la suite de la première guerre d’Irak, les Nations-Unies avaient soumis l’Irak à un système d’inspection assez strict et dans ce contexte les Etats-Unis avaient dénoncé une politique de réarmement furtive, estimant que l’Irak cherchait à se doter d’armes de destruction massive. En 2002, le Président Bush avait dénoncé un Axe du Mal. Cela a provoqué des scissions, qui n’étaient pas justifiées. Plutôt que de recourir aux armes la France et la Russie ont estimé pour s’assurer de la légitimité de la menace. Des manifestations ont eu lieu partout en Europe, l’Offensive étant malgré tout déclenchée en Mars 2003. Face à cet unilatéralisme, les Etats-Unis ont cherché à obtenir l’aval des Etats-Unis mais en tout état de cause interviendrait Gerhard Schoder, sur des questions d’importance stratégique majeure. En d’autres termes, le chancelier allemand posait la question du rôle de l’OTAN si l’un des alliés pouvaient imposer ses vues malgré l’opposition des autres. C’est en réponse à cette intervention que l’Agenda de Munich a été rédigé en Février 2005 et prévoit de renforcer le rôle de l’OTAN en tant qu’enceinte générale de consultation et de coordination stratégique entre les alliés.
§ 2. L’appui au développement d’une identité européenne d’une sécurité et d’une défense
Le traité de Maastricht le 7 Février 92 fixe l’Union Européenne, une intégration économique, de nouvelles forces et une Cour de Justice des Affaires Intérieures (CJAI) et surtout la Politique Etrangère de Sécurité Commune (PESC). Au terme du traité de Maastricht, pourrait conduire à une politique de défense commune.
Aussi, les dirigeants de l’Alliance, ont-ils dès le sommet de Bruxelles de 1994 fait savoir qu’ils apportaient leur appui au développement d’une Identité Européenne de Sécurité et de Défense IESD, qui comme le prévoit le traité de Maastricht, pourrait conduire à une défense commune, compatible avec celle de l’Alliance Atlantique. Entraîne une consolidation de l’Alliance permettant d’instaurer des rapports transatlantiques plus forts et plus équilibrés. L’appui au développement de l’IESD se traduit par l’engagement de l’OTAN a développer les rapports qui pourraient contribuer à la sécurité de l’Alliance. Cependant, double usage car les moyens de l’OTAN serviraient soient à des opérations de l’Otan en tant que tel, soit à des opérations menées par le seul pilier européen en application d’une politique de sécurité et de défense définie dans le cadre d’une autre organisation.
IESD va suivre les progrès de la coopération politique dans le cadre de l’Union Européenne, mais s’intègre en même temps à l’OTAN. Elle se développe au sein même de l’OTAN et non pas à côté. Communiqué final de Munich qui permet aux alliés européen d’apporter une contribution aux missions de l’alliance.
le Conseil Européen de Cologne en 1999 puis le Conseil Européen d’Helsinki la même année, prévoient la mise en place d’une force d’intervention rapide de 50 à 60000 hommes. Les Etats Européens s’accordent à dire que l’OTAN doit rester le fondement de la sécurité collective des membres de l’Union et que la PESC ne doit pas faire double emploi par rapport à l’OTAN. La force de réaction rapide n’est pas elle-même soumise à sa propre force de commandement, elle utilise la force de l’OTAN. Arrangement conclus entre les 2 permettant à la première de suivre l’échelle de commandement de la seconde, grâce à l’Arrangement de Berlin +, il n’est pas question de supplanter l’OTAN mais de lui donner une force secondaire.
______________________________________
Hop, voilà mon cours sur les Organisation Européennes... Bonne lecture.